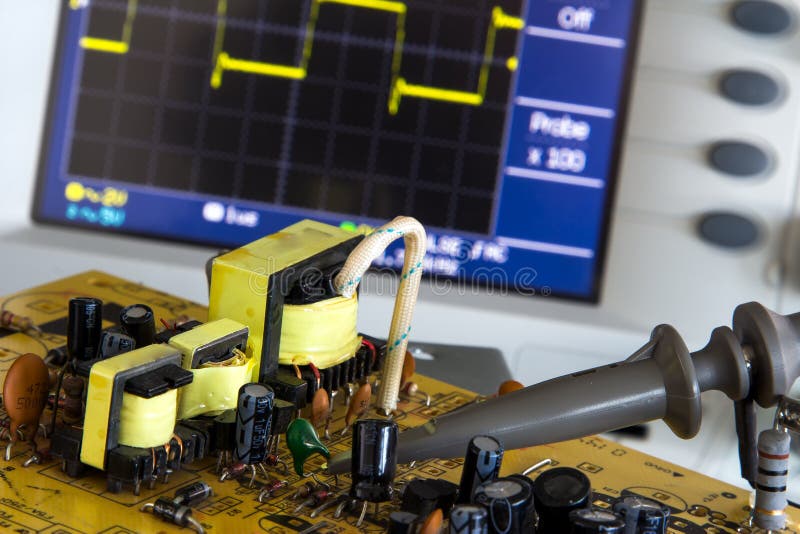- Enseignant: Caroline Trech

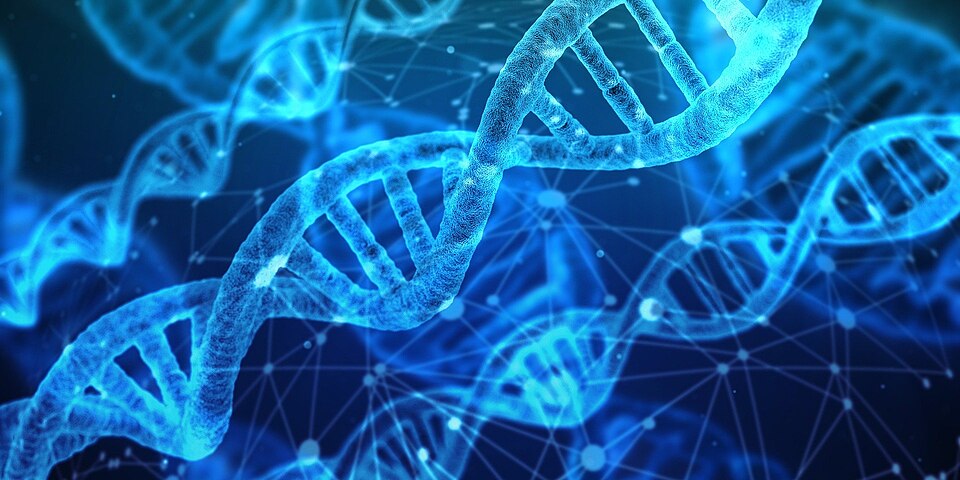
 Bonjour à tous,
Bonjour à tous,
Bienvenue dans votre espace de cours pour le semestre 2.

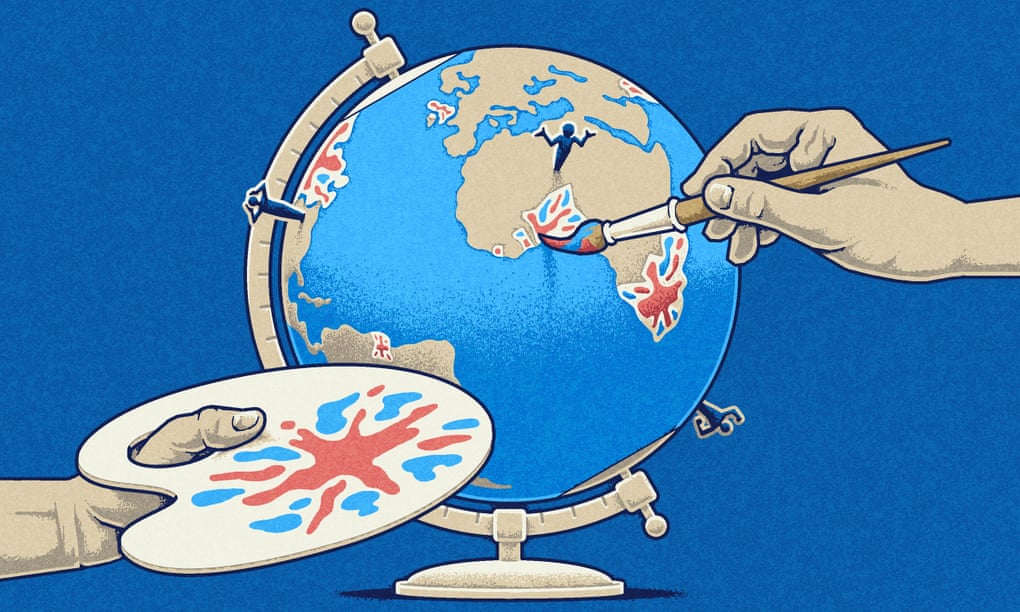
Qu’est-ce que la culture ? Comment les pratiques culturelles sont-elles traversées de rapports de pouvoir ? Comment les sociologues se sont saisis de cet objet d’étude au cours du temps ? Cet enseignement vise à interroger et à encourager la réflexivité sur une notion à première vue familière et évidente : la culture. En convoquant l’anthropologie et la sociologie, nous nous demanderons d’abord quels enjeux – sociaux, scientifiques, politiques – sous-tendent les différentes définitions de la culture. Le cours se centrera ensuite sur les pratiques culturelles, dans un sens large (sortie au musée, écoute de musique, style de vie, etc.) – en interrogeant la construction sociale du goût. Qui aime quoi ? Comment comprendre et expliquer les goûts et les dégoûts en matière culturelle ? Tous les goûts et les couleurs sont peut-être dans la nature, mais ils ne se répartissent pas au hasard et dépendent de la classe sociale, du genre, de la génération, de la race assignée, du lieu de vie des individus. En outre, certaines pratiques sont plus légitimes que d’autres. Le cours fera le point sur la théorie de la légitimité culturelle forgée par Pierre Bourdieu dans les années 1970, ainsi que sur le paradigme concurrent des cultural studies, avant d’en souligner les limites, les continuités et les évolutions à partir d’enquêtes récentes – tant quantitatives que qualitatives.
Qu’est-ce qui crée la valeur d’une production artistique ? Quelle place relative occupent les artistes, le marché, les médias, les institutions publiques ? Quels effets l’attribution d’une valeur différenciée (bon/mauvais) a-t-elle sur l’imaginaire d’une population et sur l’ordre social d’un pays ? Ce cours propose une plongée dans le milieu de l’art et de ses prescripteurs (artistes, programmateurs, journalistes, agents, politiques, etc.). À partir de l’analyse de cas concrets empruntés à différentes périodes historiques (de la naissance de l’impressionnisme au stand-up, en passant par la difficile reconnaissance institutionnelle du hip-hop), le cours questionnera comment le milieu artistique est traversé par des rapports de pouvoir, au détriment des classes populaires, des femmes, des individus racisés – relégués à la périphérie des espaces artistiques les plus consacrés. L’art – et les frontières entre art et non art – résulte d’une construction sociale et historique, traversée de luttes et de négociations. Le cours abordera les deux grands paradigmes visant à expliquer ces mécanismes (champ, monde), tout en proposant une approche socio-historique de la place du marché et de l’État, avant d’interroger l’effet sur l’imaginaire et l’ordre social.